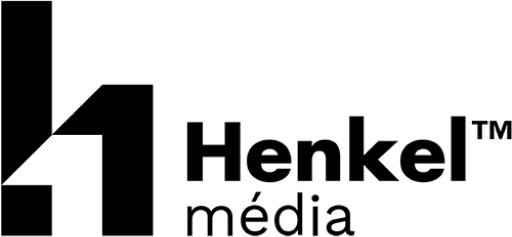Ukraine | Un conflit pas si loin de chez nous
23 mars 2022
5 minutes
Valérie Beaudoin
Experte de la politique américaine

Le Canada n’est peut-être pas sur le champ de bataille en Ukraine, mais il est clair que ses citoyens sont directement impliqués dans ce conflit qui bouleverse la planète. L’offensive russe sur ce territoire souverain ressemble étrangement à l’invasion de la Crimée en 2014, sauf qu’elle donne l’impression d’être sur les stéroïdes…
Je crois que nous sommes très loin de la politique étrangère de l’ère Trump durant laquelle l’unilatéralisme était de mise. En effet, les alliés d’autrefois étaient rarement considérés par le gouvernement américain.
Le Canada participe indirectement à l’effort de guerre, de concert avec son puissant voisin. En ajoutant les alliés européens, il est possible d’affirmer que le bloc de l’Ouest est de retour, pour reprendre l’expression issue de l’époque de la Guerre froide.
PARTAGEZ:
(
Vous pouvez aussi Aimer
)


Article
CHANDAIL FABRIQUÉ PAR MARIGOLD | « LA GUERRE, C’EST NON ! »
Mars 2022. Le monde a les yeux tournés vers l’Ukraine, et le cœur arraché.


SOCIÉTÉ & CULTURE


Chronique
RÉFORME SOCIALE AUX ÉTATS-UNIS | DES PROMESSES TROP AMBITIEUSES?
Joe Biden vient de terminer sa première année à la présidence des États-Unis et malgré plusieurs...


AFFAIRES & ÉCONOMIE
À PROPOS DE L’AUTEUR(E)

VALÉRIE BEAUDOIN
À PROPOS DE
Valérie Beaudoin est analyse et chroniqueuse de politique américaine. Elle traite de divers enjeux de cette société, qui ont souvent un impact chez nous. Elle est également chercheure associée à l’Observatoire sur les États-Unis de la Chaire Raoul-Dandurand et membre du Groupe de recherche en communication politique de l'Université Laval.
Valérie Beaudoin analyse la politique américaine pour différents médias québécois, depuis 2015, dont Radio-Canada, Noovo et le 98.5.
Au cours de son cheminement académique, elle a concentré son énergie sur les États-Unis en plus de s’y rendre régulièrement pour faire de la recherche sur le terrain, que ce soit pour couvrir une élection, une assermentation ou encore différentes manifestations aux quatre coins du pays.
Elle aime traiter de divers enjeux de la société américaine qui ont un impact chez nous. Elle s’intéresse particulièrement à la présidence, aux élections ainsi qu’aux médias.
Outre son travail d’analyste et de chroniqueuse, Valérie est chercheure associée à l’Observatoire sur les États-Unis de la Chaire Raoul-Dandurand et membre du Groupe de recherche en communication politique de l’Université Laval.

Organisations internationales
Quand je parle d’effort de guerre, je fais référence à l’abondance des sanctions économiques qui frappe la Russie du président Vladimir Poutine : limites à l’exportation, gèles d’avoirs des hommes les plus puissants de la Russie, fermeture de l’espace aérien aux avions russes, retraits de médias propagandistes au Canada, attaque de front de la devise du pays, et ce, sans compter l’isolement du pays à l’international. Ajoutons à cela les armes et les équipements militaires qui ont été donnés aux combattants du président ukrainien, Volodymyr Zelensky.
Il y a de cela à peine deux ans, l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) était affaiblie. L’ex-président des États-Unis, Donald Trump, avait mis en doute, à de nombreuses reprises, le financement de cette organisation de défense qui est aujourd’hui plus pertinente que jamais. Vladimir Poutine justifie directement son invasion de l’Ukraine par ses propres questions de sécurité et sa peur d’une expansion de l’OTAN dans d’autres pays appartenant anciennement à l’URSS, qui sont naturellement pro-russes, selon lui.
Le G7 aussi avait été durement affecté par les frictions entre le premier ministre canadien, Justin Trudeau, et Donald Trump. Rappelons-nous le fiasco de Charlevoix ! Le G7 a aussi été ébranlé par les désaccords entre l’ancienne chancelière allemande, Angela Merkel, et Trump. À ce jour, ces pays travaillent ensemble plus que jamais. C’est une coalition forte qui prend de nombreuses décisions de concert.

Pétrole russe et dépendance
Quant aux sanctions, le secteur énergétique est le sujet le plus chaud. La Russie étant le troisième producteur de pétrole au monde, un blocage de ses exportations pétrolières peut avoir un impact considérable sur certains pays européens, qui sont dépendants de celles-ci. Le Canada avait déjà annoncé à la fin février qu’il désirait interdire les importations de pétrole brut provenant de la Russie.
Du côté des États-Unis, le pétrole et les produits raffinés russes représentent seulement 8 % de leurs importations. À ce sujet, notre voisin du Sud à des partenaires beaucoup plus importants, dont le Canada. Sous la pression de membres du Congrès, autant démocrates que républicains, le président Joe Biden a annoncé qu’il allait bannir les produits pétroliers russes du marché américain.
Une mesure qui force les États-Unis à se tourner vers des pays comme le Vénézuéla, l’Arabie Saoudite et possiblement l’Iran. Qui l’eût cru, il y a trois mois ?

Impact sur le consommateur
L’impact de cette exclusion du pétrole russe d’une partie importante du marché énergétique peut avoir un effet direct sur les consommateurs américains, mais aussi canadiens. Si le prix du baril de pétrole est en hausse, c’est tout le marché international qui est affecté. Sans vouloir être porteuse de mauvaises nouvelles, ce n’est pas de sitôt qu’on pourra faire le plein à moins de 1, 60 $ le litre…
La hausse du prix de l’essence à la pompe, mariée à l’augmentation de l’inflation, met une pression immense sur les coûts des biens et des services. Ce sont les consommateurs qui écopent en payant plus cher l’essence. D’ailleurs, les prix d’une panoplie d’autres denrées sont affectés.
Aux États-Unis, l’inflation est la préoccupation numéro un des autorités, dont le gouvernement Biden. En plus d’appuyer son allié ukrainien, Washington devra trouver une façon de calmer les inquiétudes qui émanent à l’intérieur même de son pays. Un défi de taille pour Joe Biden, le mal-aimé…
Les entreprises sur le champ de bataille
La grande nouveauté de ce conflit est l’implication volontaire des entreprises. Le nombre croissant de multinationales qui ont décidé de prendre position – sans y être forcées – est fascinant. C’est probablement du jamais-vu. L’an dernier, c’est difficile d’imaginer que McDonald’s ou encore Starbucks pouvaient cesser d’offrir ses services et ses produits dans un pays pour boycotter son gouvernement. Tout ceci en faisant fi des pertes financières…
C’est pourtant ce qui s’est passé. En ajoutant de plus gros joueurs comme Visa, Mastercard, Boeing, Ford, Apple, Netflix, Spotify, Nike et Ikea (la liste va s’avérer plus longue), une tendance se dessine. Le secteur privé, outre les compagnies impliquées directement dans le soutien aux militaires, sera dans l’avenir tenté d’appuyer l’effort de guerre.
Au Canada, Bombardier a choisi de s’allier à ces multinationales. D’autres entreprises de chez nous emboîtent-elles le pas ?