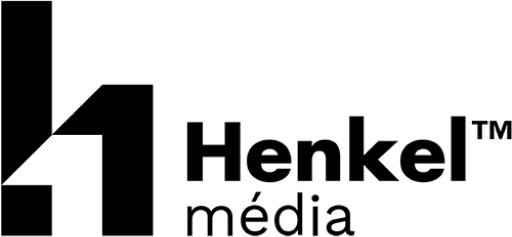.jpg)
Rédactrice, analyste, critique, Isabelle Naessens est une femme réfléchie, engagée et versatile qui a œuvré en relations internationales avant de se tourner vers la communication. Stratège relationnelle créative, elle se joint à l’équipe de Henkel Média en tant que rédactrice principale et créatrice de contenus.
ISABELLE NEASSENS
À PROPOS DE

Article
LES RESTOS NE SONT PAS MORTS !
Choquante affirmation, qu’il convient néanmoins de circonscrire pour ne pas se faire tirer dessus...


SOCIÉTÉ & CULTURE

Article
INDICE ENTREPRENEURIAL QUÉBÉCOIS 2021 : LES FEMMES ET LES...
La période des bilans 2021 bat son plein. Alors que le Canada vient de présenter l’état des...


AFFAIRES & ÉCONOMIE
(
Vous pouvez aussi Aimer
)
Dans les allées interminables de fraises, une flopée de Mexicains et de Guatémaltèques, mais aussi quelques Honduriens et Salvadoriens, cueillent à genoux, un à un, nos précieux petits fruits rouges pendant que les suit, à vitesse constante, une machine automatique. Josefina et Maria, haletantes, sont penchées sur des plants de tomates, le dos courbé. Eduardo, le front en sueur, est juché sur un tracteur alors que Juan a les mains dans le cambouis pour essayer de réparer un moteur qui ne démarre plus. Pablo, Gustavo, Yolanda et Yasmina, le visage buriné par un été caniculaire, frissonnant sous le vent de septembre, ramassent dans les champs fatigués les chairs lourdes des courges et des citrouilles, gorgées de soleil. Ce sont ces travailleurs venus de loin qui mettent nos produits locaux dans nos assiettes. Sans eux, les étals du Québec manqueraient de couleur – littéralement.

Des travailleurs essentiels
Il y a 50 ans, c’étaient les familles, les enfants, les cousins, les voisins qui exploitaient les nombreuses petites fermes du Québec. Mais aujourd’hui, nos champs ont été désertés. Le Conseil canadien pour les ressources humaines en agriculture (CCRHA) statue : « L’industrie agricole canadienne vit une pénurie croissante de main-d’œuvre qui se transforme en crise du travail ».
Avec l’urbanisation, les installations se sont raréfiées mais la production agricole a continué de prendre de l’ampleur en termes de volume. En haute saison, les fermes qui ont besoin de récolter à mains nues ont besoin de plusieurs dizaines de travailleurs supplémentaires, comme à la Ferme Pittet, en Mauricie, qui serait forcée d’abandonner une partie de ses activités si elle n’avait pas ces travailleurs temporaires. Certaines entreprises en embauchent même des centaines, comme aux Fraises de l’île d’Orléans, ou aux Serres Lefort à Sainte-Clotilde, qui reçoivent près de 200 travailleurs étrangers chaque été sur une population de 2250 habitants!

L’entrepreneur à la tête du Potager Riendeau à Saint-Rémi, en Montérégie, estime que ses 3000 temporaires « sauvent les entreprises d’ici. Sans eux, les multinationales américaines auraient fait une bouchée des entreprises familiales québécoises. On n’aurait pas pu être gros et faire de la qualité en étant productifs.»
La pandémie a mis en relief l’importance des travailleurs étrangers aux yeux des citadins qui boudaient l’agriculture. Le fameux panier bleu et l’importance d’acheter local y a été pour beaucoup. Quand le gouvernement a lancé l’appel aux Québécois à aller travailler dans les champs, il y a eu un engouement temporaire, mais peu d’inscrits sur le terrain. Par ailleurs, les candidats palissaient en comparaison avec les travailleurs étrangers qui n’ont pas peur des grosses journées chaudes, qui sont présents toute la saison, expérimentés, habitués à travailler rapidement, qui maîtrisent des techniques et des connaissances, comme la capacité à réparer de l’équipement, à reconnaître des maladies et ravageurs des champs, etc.
Chez eux, ils sont souvent employés dans l’agriculture ; ici, les travailleurs étrangers sont devenus partie intégrante du fonctionnement des fermes québécoises.
Le CCRHA a estimé qu’à elles seules, les pénuries de main-d’œuvre ont fait perdre des centaines de millions de dollars à l’industrie, un chiffre qui continue d’augmenter. « Si ces travailleurs agricoles étrangers n’étaient pas présents, soit les fruits ne seraient pas récoltés, soit les producteurs devraient en produire moins, ça serait une perte », analyse l’économiste agroalimentaire Dimitri Fraeys du Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ). « Le secteur présente une grande dépendance à l’égard des travailleurs étrangers », n’hésite pas à conclure le CCRHA.

Tout un contrat!
Le Programme des travailleurs agricoles saisonniers (PTAS) du fédéral permet aux employeurs d’embaucher des travailleurs étrangers temporaires (TET), pour un maximum de huit mois, pourvu qu’ils puissent offrir au moins 240 heures de travail, au cours d’une période ne dépassant pas six semaines.
Les employeurs doivent soumettre leurs besoins en main-d’œuvre et démontrer leurs efforts de recrutement local, c’est-à-dire qu’aucun Canadien ou résident permanent n’est disponible. Il faut compter un délai de cinq mois environ. L’entreprise doit assumer les frais reliés au transport et fournir une assurance-maladie, ainsi qu’un logement adéquat et un contrat à temps plein en bonne et due forme (minimum 30 heures par semaine).
Le programme bat des records ces dernières années. Le nombre de ces temporaires à bas salaire en agriculture augmente d’année en année. C’est environ 25 000 travailleurs étrangers qui viennent chaque été donner un coup de main aux entreprises agricoles.
Si la plupart d’entre eux séjournent de quatre à cinq mois, du printemps à la fin de la période estivale, quelques-uns viennent travailler au Québec pour huit mois, et ce, pendant plusieurs années. Ils reviennent tant qu’il est possible de le faire. Mais cela ne leur donne pas un accès direct à la résidence permanente, loin de là. C’est un vase clos.
Le permis de travail est fermé, c’est-à-dire qu’il est associé à un employeur unique. Les travailleurs se trouvent donc dans une grande vulnérabilité, ayant souvent peur de dénoncer leur employeur puisque ce dernier a le pouvoir de les renvoyer dans leur pays.

Les producteurs ont en effet eu mauvaise presse relativement aux conditions de vie et de travail des immigrants ces dernières années. Entassés dans des petits logements sans air ni aucune intimité, travaillant à mains nues dans des champs pleins de pesticides, avec une cadence difficile à soutenir à la chaleur, dans des positions éreintantes pendant des heures, discriminés, etc. Il semblerait pourtant, selon la Fondation des entreprises en recrutement de main d’œuvre agricole étrangère (FERME) que ce soit de moins en moins le cas : les logements sont inspectés, il y a une ligne d’entraide en espagnol, des directives pour la santé et la sécurité. Le recrutement de travailleurs agricoles saisonniers semble être une solution gagnante pour tous…

Le Québec, un Eldorado?
Les travailleurs agricoles saisonniers gagneront cet été 12,50$/heure, le salaire minimum. « Pour les agriculteurs, l’augmentation des salaires est un peu plus difficile à avaler, a affirmé le président de l’Union des producteurs agricoles. Dans certains secteurs, notamment les petits fruits, les coûts en main-d’œuvre représentent plus de 50% des dépenses de l’entreprise. »
Les salaires peuvent nous paraître dérisoires pour ce travail ardu, du matin au soir, soixante heures, souvent six jours par semaine. Du cheap labour? C’est pourtant dix à vingt fois plus que ce qu’ils gagnent chez eux. Le salaire agricole moyen au Mexique est de 12$/jour, et de seulement 5$/jour au Guatemala. Ces mois de dur labeur permettent aux travailleurs de rapporter chez eux un bon pécule de la Belle Province.
Prenez-vous soin de vos travailleurs saisonniers?
2023-05-30
ISABELLE NEASSENS
7 minutes

Alors que le débat sur le seuil de l’immigration est d’actualité, nombreux sont les employeurs qui n’attendent que davantage de main d’œuvre étrangère pour venir combler le vide. En particulier dans le secteur agricole, où il en manque pas moins de 30,000 au bas mot. Il est question de la relève à long terme, certes, mais aussi du labeur de bras à court terme. Été après été, ces milliers d’étrangers font la corvée des champs de la Montérégie, de l’Estrie, des Basses-Laurentides, de Lanaudière et de l’île d’Orléans. Ils désherbent, ensemencent, labourent, arrosent, cueillent, coupent, récoltent, ensachent…
PARTAGEZ: