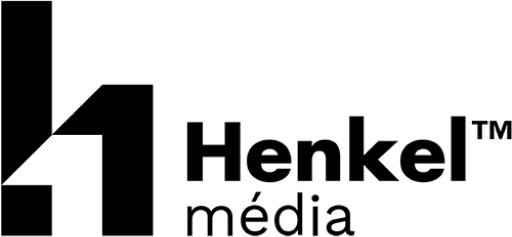%201.png)
Henkel Média est une plateforme numérique dédiée à inspirer la communauté d’affaires et à offrir des solutions aux défis actuels. Nous mettons en lumière des acteurs clés du milieu des affaires en racontant leurs histoires et en faisant rayonner leur savoir-faire. Engagés à promouvoir des pratiques plus humaines, responsables et inclusives, nous soutenons ceux qui osent faire une différence et aspirons à laisser une empreinte positive sur l'ensemble de l'écosystème professionnel.
HENKEL
À PROPOS DE
(
Vous pouvez aussi Aimer
)
Imaginez une école transformée en refuge pour chats. Des garderies reconverties en maisons de retraite. Des fabricants de lait pour bébés qui vendent maintenant des smoothies aux seniors. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est la réalité en Corée du Sud aujourd'hui [1].
Avec seulement 0,75 enfant par femme, la Corée détient le record mondial de la faible natalité. Mais elle n'est pas seule. La France vient d'enregistrer son taux le plus bas depuis 1918 : 1,62 enfant par femme [2]. Au Québec, c'est encore pire avec 1,33 enfant par femme [3]. Même la Chine, le Brésil et les États-Unis sont passés sous la barre fatidique de 2,1 enfants par femme - le minimum pour renouveler une population.
Les chiffres qui font peur
Les statistiques donnent le vertige. En France, 663 000 bébés sont nés en 2024, soit 21% de moins qu'en 2010 [4]. Au Québec, l'âge moyen pour avoir son premier enfant est passé de 27 ans en 1976 à 30 ans aujourd'hui [5]. Et ce n'est que le début : selon l'ONU, les deux tiers de la planète vivent déjà dans des régions où on fait moins d'enfants qu'il n'en faut pour maintenir la population [6].
En Corée du Sud, si la tendance continue, chaque génération ne représentera qu'un tiers de la précédente. Concrètement, ça veut dire qu'un pays de 51 millions d'habitants pourrait se retrouver avec 17 millions dans 30 ans.
"C'est trop cher !"
La première explication qui vient à l'esprit, c'est l'argent. Et c'est vrai que les chiffres font mal. Élever un enfant jusqu'à 25 ans coûte 264 000 euros en France - soit le prix d'un appartement [7]. Au Canada, c'est 300 000 dollars jusqu'à 17 ans seulement [8].
Une récente enquête de l'ONU auprès de 14 000 personnes dans 14 pays confirme cette réalité [9]. En Corée du Sud, 58% des gens citent l'insécurité financière comme frein principal. Même en Suède, pourtant réputée pour ses aides sociales, ils sont encore 19% à s'inquiéter de l'argent.
Mais attention : contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas juste une question de revenus. Même les couples aisés font moins d'enfants qu'avant. Le problème est plus profond.
Les femmes ont d'autres projets
La vraie révolution, c'est l'émancipation des femmes. Aujourd'hui, elles font des études, ont des carrières, voyagent. Avoir des enfants à 20 ans ? Très peu pour elles. Au Québec, 56% des bébés naissent maintenant de couples en union libre, pas mariés [10]. Les femmes ne se sentent plus obligées de suivre le schéma traditionnel.
Le problème, c'est que malgré tous les discours sur l'égalité, ce sont encore elles qui s'occupent principalement des enfants. Cette "double journée" - boulot le jour, enfants le soir - en décourage plus d'une. Comme le dit Sophie, 35 ans, cadre à Montréal : "Même avec 100 000 dollars, je n'aurais pas eu un quatrième enfant. Je voulais retourner au travail."
L'angoisse du futur
Une nouvelle peur s'ajoute : l'écoanxiété. 19% des gens interrogés par l'ONU citent le changement climatique comme raison de ne pas avoir d'enfants [11]. "Pourquoi mettre un enfant au monde s'il va vivre l'apocalypse climatique ?" se demandent beaucoup de jeunes.
Cette angoisse dépasse l'environnement. Guerres, crises économiques, instabilité... L'avenir semble incertain. Avoir des enfants, c'est faire un pari sur l'avenir. Un pari que beaucoup ne veulent plus prendre.
Les gouvernements paniquent (et se trompent)
Face à cette situation, les politiques sortent l'artillerie lourde. En Chine, des fonctionnaires appellent les femmes pour connaître leur cycle menstruel [12]. En Turquie, on interdit les césariennes non médicales. En Hongrie, les mères de deux enfants ne paient plus d'impôts.
Résultat ? Ça ne marche pas. L'exemple du Québec est parlant : en 1988, le gouvernement offrait jusqu'à 8 000 dollars pour un troisième enfant. "Ça marche un petit bout de temps, puis les gens reviennent à leurs habitudes", explique Sophie Mathieu, spécialiste des politiques familiales [13].
Pourquoi ces mesures échouent-elles ? Parce qu'elles ne s'attaquent pas au vrai problème. Donner de l'argent, c'est bien. Mais si les crèches manquent, si les horaires de travail sont impossibles, si les femmes doivent choisir entre carrière et famille, ça ne sert à rien.
Ce qui marche vraiment
Les pays qui s'en sortent le mieux ne misent pas sur les primes, mais sur la qualité de vie. La Suède, par exemple, offre des congés parentaux partagés entre père et mère, des crèches abordables, des horaires flexibles. Résultat : seulement 19% des Suédois s'inquiètent de l'argent pour avoir des enfants, contre 58% en Corée du Sud [14].
Mais même la Suède ne remonte pas vraiment sa natalité. Pourquoi ? Parce que le problème dépasse les politiques publiques. Nos modes de vie ont changé. Nos priorités aussi.
Une révolution silencieuse
Ce qu'on vit, c'est une révolution des mentalités. Avant, avoir des enfants était automatique, obligatoire même. Aujourd'hui, c'est un choix. Et ce choix, beaucoup le reportent ou y renoncent.
Les nouvelles générations veulent d'abord voyager, faire carrière, profiter de la vie. Elles ne voient plus la parentalité comme un passage obligé vers l'âge adulte, mais comme une option parmi d'autres. Une option coûteuse, contraignante, et pas forcément épanouissante.
Cette transformation reflète aussi une élévation des standards. Nos grands-parents se contentaient de nourrir et habiller leurs enfants. Nous, on veut leur offrir le meilleur : écoles privées, activités extra-scolaires, voyages éducatifs... Le "coût" d'un enfant a explosé, pas seulement financièrement, mais aussi en temps et en énergie.
L'immigration, solution miracle ?
Face à cette réalité, certains pays misent sur l'immigration. Au Québec, 40% des nouveau-nés ont déjà au moins un parent né à l'étranger [15]. C'est trois fois plus qu'en 1980. L'immigration compense en partie la baisse de natalité, mais elle soulève d'autres questions sur l'identité et l'intégration.
Et maintenant ?
Faut-il paniquer ? Pas forcément. Cette transition démographique peut aussi être vue comme une chance. Moins d'enfants, mais mieux éduqués et accompagnés. Des sociétés plus durables, moins consommatrices de ressources.
Le défi, c'est d'adapter nos systèmes à cette nouvelle réalité. Repenser les retraites, optimiser la productivité, mieux intégrer les immigrés. Et surtout, arrêter de culpabiliser ceux qui choisissent de ne pas avoir d'enfants.
Comme le souligne le rapport de l'ONU : "Les gens veulent des enfants, mais disent que les conditions ne sont pas bonnes" [16]. Le problème n'est pas un rejet de la parentalité, mais l'inadéquation entre nos aspirations et nos réalités.
Conclusion : accepter le changement
La baisse de la natalité dans les pays riches n'est ni une crise temporaire ni un caprice de jeunes égoïstes. C'est le reflet d'une société qui a évolué, où l'autonomie individuelle prime sur les injonctions collectives.
Plutôt que de forcer les gens à faire des enfants, mieux vaut créer les conditions pour que ceux qui le souhaitent puissent le faire sereinement. Crèches accessibles, horaires flexibles, partage équitable des tâches domestiques, soutien aux familles... Voilà les vraies solutions.
Car au final, la question n'est pas de savoir combien d'enfants nous faisons, mais dans quelles conditions nous les élevons. Et sur ce point, il y a encore du travail.
Sources
[1] Radio-Canada, "Les taux de natalité sont en chute libre", juin 2025 [2] INSEE, "Bilan démographique 2024", janvier 2025 [3] Institut de la statistique du Québec, "Naissances et fécondité", mai 2025 [4] INSEE, op. cit. [5] Institut de la statistique du Québec, op. cit. [6] INED, "Baisse massive de la fécondité mondiale", janvier 2024 [7] Capital, "Avoir un enfant coûte aussi cher qu'un appartement", mars 2025 [8] Les Affaires, "Coûts associés à l'arrivée des enfants", mai 2025 [9] UNFPA, "La véritable crise de la fécondité", juin 2025 [10] Institut de la statistique du Québec, op. cit. [11] UNFPA, op. cit. [12] Radio-Canada, op. cit. [13] Ibid. [14] UNFPA, op. cit. [15] Institut de la statistique du Québec, op. cit. [16] UNFPA, op. cit.
Pourquoi personne ne veut plus faire d'enfants ?
2025-10-09
HENKEL
6 minutes

Les berceaux se vident partout dans le monde. En France, au Québec, en Corée du Sud... Même les politiques les plus généreuses n'y changent rien. La vraie raison ? Nos priorités ont changé.
PARTAGEZ: