
Mélissa Proulx est une journaliste, chroniqueuse et rédactrice. Elle se consacre avec passion et créativité à l’élaboration de contenus journalistiques riches et variés depuis 2002.
Bachelière en lettres françaises de l’Université d’Ottawa et diplômée en journalisme, Mélissa Proulx avait 21 ans lorsqu’on lui a confié les rênes de l’hebdomadaire culturel Voir Gatineau-Ottawa, une édition régionale qu’elle a dirigé pendant huit ans. Sa route l’a ensuite ramenée vers sa région où elle a été chef de la section Art de vivre du Voir Montréal puis comme rédactrice en chef adjointe du magazine Enfants Québec.
MÉLISSA PROULX
À PROPOS DE

Videos
IDÉES DE TRANSFORMATION NUMÉRIQUE
La transformation numérique est un terme qui résonne dans toutes les sphères d’affaires...


TECHNOLOGIE & INNOVATION

Videos
DÉCOUVRIR LANAUDIÈRE | EP5 : AGROALIMENTAIRE
La région de Lanaudière ne se contente pas d’offrir des panoramas à couper le souffle...


AFFAIRES & ÉCONOMIE
(
Vous pouvez aussi Aimer
)

L’étincelle pour les sciences:
«Le livre Les Débrouillards quand j’étais petite. Il y a avait un petit livret d’expériences qui l’accompagnait. Je n’en ai pas nécessairement réalisé un grand nombre, mais j’aimais voir tout ce qu’on pouvait faire. Avoir un grand-père radiologiste et un père ayant étudié en physiologie m’a certainement influencée aussi.»
Son choix de carrière:
«Je l’ai fait à la dernière minute! J’aimais les sciences, la biologie et le dessin. Je voulais dessiner des planches anatomiques comme le faisait la tante de mon père, mais l’orienteur m’a dit qu’il n’y avait pas beaucoup de débouchés! (rires) À l’époque, mon père pilotait un petit avion pour le plaisir. Je suis rentrée à l’université en génie mécanique en me disant que je pourrais dessiner des avions. Comme plusieurs, j’ai été un peu étonnée lorsque j’ai découvert le contenu de mes cours!»
Sa spécialisation:
«J’ai fait des stages en entreprise pour vite comprendre que ce n’est pas ce qui m’intéressait. Un nouveau professeur spécialisé en bio-ingénierie est arrivé à l’université et c’est vers cette branche du génie mécanique que je me suis dirigée pour ma maîtrise, mon doctorat et mon postdoctorat. Après avoir eu mon premier enfant, je me suis retrouvée à faire mon post-doctorat à Québec où résidait mon conjoint jusqu’à ce qu’on m’offre un poste de professeure en génie mécanique à l’Université de Sherbrooke.
Ma spécialité se divise en deux volets: je m’intéresse d’une part à la mécanobiologie des tendons puis, d’autre part, à ramener la mobilité chez les personnes ayant des limitations physiques».
La passion:
«Il est très exigeant d’apprendre la biologie, la biochimie, la pharmacologie en plus du génie mécanique, mais c’est absolument fascinant de comprendre comment notre corps fonctionne! Ce qui me motive le plus, c’est l’impact positif que peuvent avoir nos recherches pour aider à guérir plus rapidement, à prévenir les blessures ou à développer des outils pour les jeunes athlètes paralympiques, par exemple.»
«Contrairement à ce que l’on est parfois porté à penser, le génie mécanique ne s’intéresse pas à la mécanique automobile. Et le génie électrique ne consiste pas relier des fils d’électricité. Le mot génie tend à intimider aussi plusieurs jeunes filles. Il y a donc tout ce travail de démystification pour contrer les idées préconçues dès l’école primaire».
La chaire:
«Notre mission est d’augmenter la représentation des femmes en sciences et en génie (SG). Je veux faire tomber les barrières que les femmes et les filles peuvent rencontrer depuis l’enfance jusqu’au marché du travail afin qu’elles viennent en SG, y restent et y soient heureuses. Un de mes objectifs est de sensibiliser les professeurs, collègues, chefs d’entreprise à ce que les femmes peuvent apporter de différent, mais aussi aux façons de les approcher.»
«Dans les domaines du génie (électrique, mécanique, informatique), les femmes sont peu présentes (11%, 13% et 16% des inscriptions au baccalauréat dans ces domaines respectivement). Dans d’autres domaines comme la biologie, on pense parfois à tort que le dossier est réglé, car la parité est atteinte. Or, plus on monte dans la hiérarchie des postes décisionnels, moins il y a de femmes. Ce sont majoritairement des hommes qui décident de l’avenir de la recherche et de l’enseignement dans le milieu. »
«Il faut donner des modèles accessibles aux jeunes filles et rendre les femmes scientifiques plus visibles dans la société, dans toute leur singularité et leur diversité. Montrer des femmes avec des enfants, sans enfants, des passionnés de musique ou de sport. Et non pas juste celles qui brillent au top.»
Et brillent les femmes en sciences!
2019-02-13
MÉLISSA PROULX
4 minutes

Ingénieure-chercheuse s’étant spécialisée en biomécanique, professeure agrégée à l’Université de Sherbrooke, Eve Langelier est aujourd’hui titulaire de la Chaire de recherche pour les femmes en sciences et en génie au Québec. La progression et le rayonnement des femmes dans ces domaines, elle s’en fait une mission quotidienne.
PARTAGEZ:
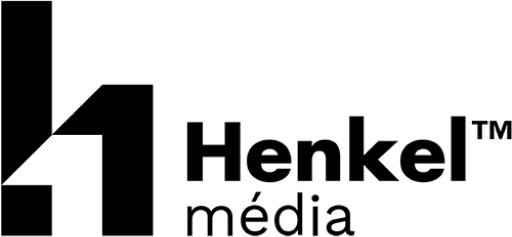

.webp)

.jpg)

